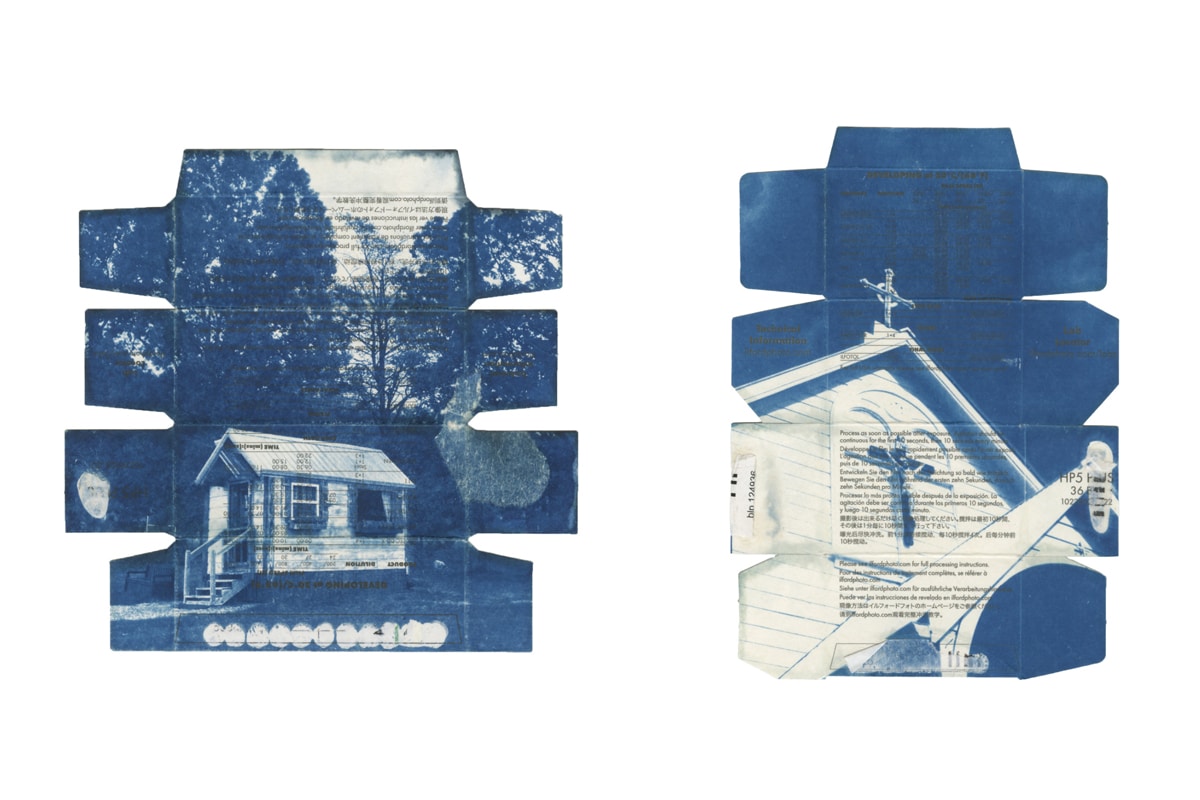Le mois d'octobre a été très chargé pour Edward Burtynsky. L'artiste canadien a notamment publié une nouvelle série de ses photographies, intitulée Anthropocène, jusqu'au 3 novembre à la Nicholas Metivier Gallery de Toronto. Avec ses collaborateurs Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier, il a également lancé l'exposition muséale itinérante Anthropocène au Galerie d'art de l'Ontarioet son dernier long métrage Anthropocène : L'ère humainequi est à l'affiche du TIFF jusqu'au 11 octobre.
Burtynsky est surtout connu pour ses photographies aériennes qui illustrent les effets sociétaux et écologiques des systèmes humains sur la terre, idées qu'il a développées dans ses précédents documentaires. Paysages manufacturés (2006) et Filigrane (2013).
Nous avons contacté Burtynsky pour en savoir plus sur le projet Anthropocène et sur la manière dont il revisite les thèmes et les lieux explorés dans ses œuvres précédentes.
Format Magazine : J'ai été surprise d'apprendre que vous n'aviez pas encore utilisé le mot "Anthropocène" pour qualifier votre travail, car il semble être le terme parfait. Je voulais vous demander comment votre travail répond à ce sujet.
Edward Burtynsky : Pour en revenir au mot Anthropocène, il a été inventé par un gentleman, Paul J. Crutzen, lauréat du prix Nobel. Dans les années 2000, il a estimé que l'impact de l'homme sur la planète était suffisamment important pour avancer l'idée que nous étions entrés dans une nouvelle ère. L'agence de cette époque est l'homme. On en trouve la preuve dans toutes sortes d'endroits différents. Les scientifiques qui se sont penchés sur la question cherchaient des preuves géologiques. Les choses que nous laissons [derrière nous] laisseront des traces de ce que nous sommes, et ces traces s'étendront loin dans l'avenir.
Par exemple, l'aluminium, le béton, les alliages et les plastiques ne peuvent pas être créés par la nature. Ainsi, ces éléments, lorsqu'ils sont pris dans les sédiments et dans les différents endroits où les plastiques peuvent se concentrer, les géologues de demain, dans deux millions d'années, en creusant une couche [de sédiments], diront : "Oh, c'est à ce moment-là que les humains ont fabriqué le plastique et l'ont répandu sur toute la planète."
Les scientifiques ont cherché à savoir quel était le moment de l'Anthropocène. Quelle est cette signature sur la planète ? La période la plus citée et la plus appréciée est celle des essais nucléaires effectués dans les années 50, 60 et 70. Toutes ces radiations sont tombées sur la planète, il y a donc une signature. Que vous soyez au pôle Nord ou au pôle Sud, dans les océans ou sur le mont Everest, vous trouverez des radionucléides provenant des essais effectués. Ces radionucléides sont omniprésents. Ils considèrent cela comme la signature potentielle de l'Anthropocène.

Edward Burtynsky, Dandora Landfill #3, Plastics Recycling, Nairobi, Kenya, 2016. Impression à jet d'encre pigmentaire sur papier photo professionnel Kodak © Edward Burtynsky, avec l'aimable autorisation de la Metivier Gallery, Toronto.
Il s'agit donc de l'horodatage de l'impact de l'intervention humaine. J'ai lu l'ouvrage de Timothy Morton intitulé Écologie sombreoù il parle un peu de l'Anthropocène.
Oh, je viens de le prendre et de commencer à le lire !
C'est très bien ! L'une des choses que j'ai apprises de lui, c'est de penser à la terre comme à une entité à part entière - pas seulement aux humains et à la façon dont la terre existe pour nous, mais aussi à l'impact que nous avons sur elle et à ce qu'elle pourrait être après notre disparition. Avez-vous une perspective similaire sur l'Anthropocène ?
Un article a récemment été publié dans le Guardian. à propos de James LovelockC'est un spécialiste des sciences de la terre, et le premier à avoir élaboré la théorie Gaia, selon laquelle on ne peut pas étudier un système indépendamment des autres. On ne peut pas s'intéresser uniquement à l'atmosphère et apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les atmosphères sans parler aux océanologues et aux spécialistes de la terre.
Tout est lié. Pour comprendre ce qui se passe, il faut un scientifique qui étudie la terre, l'océan et l'air, les trois à la fois. De nos jours, nous avons encore des silos. James Lovelock dit que non, non, ils ont tous un impact les uns sur les autres en permanence. Nous sommes un système fermé. On ne peut pas s'intéresser à une seule chose. Il faut tenir compte de tout.
Penser à une vision holistique de ces questions est un bon moyen de revenir à votre travail. Je sais que la perspective de votre travail, la photographie aérienne, la résolution d'images denses et la manière technique dont vous réalisez votre travail renforcent et soutiennent l'idée d'une vue d'ensemble. Vos photographies nous permettent de voir cet excès et cet impact sur la surface du monde que nous ne pourrions pas voir sans ces stratégies. Pouvez-vous nous parler des aspects techniques de votre travail et de la manière dont ils soutiennent les questions auxquelles vous réfléchissez ?
Si vous regardez mon travail, même au début des années 80, je n'avais qu'un nombre limité d'options. Je photographiais en 8×10 et 4×5. Je photographiais des mines et des carrières. J'ai toujours aimé ce type de perspective où l'espace s'aplatit, où le premier plan commence au loin. On se retrouve alors face à un mur d'informations. J'ai toujours été intrigué et intéressé par ce dispositif visuel pour parler de ces systèmes humains à grande échelle sur la planète, qu'il s'agisse d'une mine, d'une carrière ou de n'importe quel autre système humain que je regardais.
Plus tard, j'ai travaillé sur un projet concernant l'eau et la façon dont nous construisons des systèmes pour contrôler et diriger l'eau, comme les barrages et les systèmes d'irrigation. J'ai parcouru la Californie en essayant de faire quelque chose, mais je n'arrivais pas à monter assez haut sur l'ascenseur que j'utilisais.

Edward Burtynsky, Scierie #2, Lagos, Nigeria, 2016. Impression à jet d'encre pigmentaire sur papier photo professionnel Kodak © Edward Burtynsky, avec l'aimable autorisation de la Metivier Gallery, Toronto.
Travailliez-vous déjà en numérique à l'époque ?
Je suis passé au numérique en 2005. J'ai découvert que la prise de vue numérique à partir d'un hélicoptère était meilleure que la prise de vue argentique. Tout d'un coup, la photographie aérienne en numérique était meilleure. J'ai donc commencé à acquérir de la technologie numérique et des stabilisateurs gyroscopiques pour mon appareil photo. En 2007, j'ai commencé à travailler sur mon premier projet entièrement numérique, qui consistait à photographier des mines en Australie. Je louais des avions et des hélicoptères pour effectuer ce travail. C'était vraiment ma première série de vues aériennes.
J'ai été fasciné par la façon dont cette perspective plus élevée de 500, 600, 700, 800 pieds m'a révélé beaucoup de choses, d'une manière plus convaincante. Cela m'a permis de comprendre comment je pouvais vraiment montrer ce qui se passait.
Il est beaucoup plus facile de trouver un moment surréaliste dans ces lieux où l'échelle, la couleur et la combinaison, tout cela, vous transporte dans un endroit qui n'est pas de ce monde - bien qu'ils le soient.
Je n'arrêtais pas d'ajuster mes hauteurs en fonction du sujet. J'ai réalisé un autre projet en Espagne, et j'ai essayé de respecter la règle des 700-800 pieds, mais cela n'a pas fonctionné, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le lendemain, j'ai donc voulu monter, et j'ai continué à monter. J'ai découvert que c'est autour de 1500-1800 pieds que le sujet devenait vraiment intéressant. Je me suis donc dit : tant pis pour cette règle ! Laissez le sujet vous indiquer où aller. J'ai commencé à utiliser cette règle : laisser mon sujet me guider pour déterminer où me placer. Finalement, j'ai commencé à considérer l'hélicoptère comme un trépied étendu.
Supposons que je tourne avec un film et que le résultat sur le mur, sur un grand tirage, soit meilleur que le numérique. Dans ce cas, je n'opterais pas pour le numérique. Ma règle est la suivante : si le résultat est meilleur, j'opte pour le meilleur résultat.
Vous ne vous souciez pas de savoir si c'est plus récent ou plus chic, c'est ce qui fonctionne le mieux ?
Oui. C'est exact. Nous utilisons également la photogrammétrie, qui consiste à prendre plusieurs photographies numériques bidimensionnelles d'un objet pour créer une photographie tridimensionnelle.
C'est pour votre travail sur la réalité augmentée à l'AGO ? Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ces projets ?
Oui. C'est notre première tentative vraiment réussie d'utilisation de la RA. Encore une fois, j'essaie de ne pas l'utiliser simplement parce que c'est un nouvel objet brillant avec lequel on peut jouer. Il s'agit plutôt de savoir comment je peux prendre quelque chose en 3D et m'en servir d'une manière qui a du sens, qui crée et fait quelque chose que la photographie ne peut pas faire. Cela a donc une importance et une signification pour mon travail, et s'inscrit dans le contexte des questions plus vastes que j'essaie d'aborder dans le cadre de mon travail.
Pour le projet Anthropocène, nous [les collaborateurs Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier] avons tous décidé de brûler les piles de défenses. [Brûler les défenses était une initiative du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, pour protester contre le braconnage des éléphants dans le pays]. Il s'agissait des défenses de 8 000 éléphants, soit environ 16 000 défenses ; il y avait 11 piles de ces défenses. Il a fallu une semaine pour construire ces pyramides de défenses. Nous avons passé toute la semaine avec eux à les sortir des conteneurs, à les placer sur ces bûchers et à les brûler.
Le président avait une pile de ces super défenses. Ces défenses sont si grosses qu'il faut être deux pour les porter. On peut imaginer que lorsqu'un braconnier se rend dans un troupeau d'éléphants, il regarde qui a les plus grosses défenses - c'est ce qui rapportera le plus en termes de valeur. Ils s'intéressent donc aux grands éléphants mâles, les tuent et coupent les défenses à la tronçonneuse.
On dit qu'il en reste moins de 100 dans toute l'Afrique, tant ils ont été malmenés par les braconniers. Cette pile d'énormes défenses provient des plus gros éléphants d'Afrique. Nous voulions photographier ce bûcher et nous y avons donc eu accès pendant quelques heures. Sachant utiliser la photogrammétrie, nous avons pris 2 500 images de tous les points de vue et de tous les recoins. Aujourd'hui [au Musée des beaux-arts de l'Ontario], nous avons recréé cet amas de défenses en 3D, de sorte que vous pouvez maintenant le voir dans son intégralité, presque à l'échelle. Vous pouvez maintenant marcher autour de la pile. D'une certaine manière, il s'agit d'une image, mais plutôt d'une image sculpturale. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou un iPad pour vous déplacer autour de la pile ; vous pouvez vous rapprocher ou reculer. C'est un moyen de faire revivre ce moment sous la forme d'une expérience numérique tridimensionnelle de ce tas.
Tous mes paysages ne sont pas des paysages de catastrophe, ce sont des paysages de routine. Ce sont les choses que nous créons.

Edward Burtynsky, Soutes pétrolières #4, Delta du Niger, Nigeria, 2016. Impression à jet d'encre pigmentaire sur papier photo professionnel Kodak © Edward Burtynsky, avec l'aimable autorisation de la Metivier Gallery, Toronto.
C'est assez dévastateur de penser à ces défenses et à ce qu'elles représentent au niveau plus large de la façon dont les braconniers traitent les animaux. J'imagine que la pièce AR est également très captivante sur le plan visuel, même si elle est déchirante. Je me demande comment vous envisagez de créer de belles images de choses dévastatrices. La beauté est-elle un élément de votre travail ? Est-ce que le fait d'être photographe vous pousse à vouloir créer une image attrayante ? Pensez-vous à cette négociation ?
Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens disent qu'il s'agit d'images de dévastation. On peut sans doute dire cela, mais on peut aussi dire que nos villes sont assises sur ce qui était autrefois des forêts - ce sont des forêts dévastées. Aujourd'hui, nous disposons de tous ces matériaux que nous avons récoltés dans la nature, et nos villes sont donc également des images de dévastation. C'est un problème complexe dans lequel nous nous trouvons.
Tous mes paysages ne sont pas des paysages de catastrophe, ce sont des paysages de routine. Ce sont les choses que nous créons. Dans une mine ou une carrière, il y a de la conception et de l'ingénierie. Nous avons des ingénieurs qui coupent de telle ou telle manière. Dans ces paysages, tout est réfléchi. Ils sont planifiés et conçus. Mais c'est vraiment la forme qui suit la fonction au sens propre du terme.
Personne n'essaie de créer une esthétique dans ces mines ou cette raffinerie ; ils essaient d'obtenir un résultat et de dépenser le moins d'argent possible pour un rendement maximal. Ils ne vont pas gaspiller de l'énergie pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Tout est le moyen le plus économique et le plus rapide technologiquement pour accomplir cette tâche, pour obtenir ce matériau, parce que cela a un impact sur la rentabilité de l'opération. Je comprends donc qu'il s'agit de paysages très intentionnels et conçus et qu'ils sont, en ce qui me concerne, équivalents à nos villes. Nous n'aimons peut-être pas leur aspect.

Burtynsky au travail, désert d'Atacama, Chili (2017). Avec l'aimable autorisation de Jim Panou.
Je pense que c'est plutôt le contraire - les photographies sont très étonnantes, elles sont tellement picturales et beaucoup d'entre elles ressemblent à des textiles. Je m'interrogeais sur la manière dont vous concevez la composition d'une image. Pensez-vous que la beauté fonctionne comme un moyen d'amener les gens à réfléchir plus profondément à ces choses ?
J'ai réalisé un projet avec Brent McIntosh, il y a peut-être dix ans, qui s'intitulait Deux fois retiré. J'ai pris des photos de la nature et Brent a ensuite réalisé une peinture à partir des photos que j'avais prises. C'était très tôt, à la fin des années 70 et au début des années 80. Avant de documenter les mines, je regardais ces paysages, en particulier lorsque les feuilles sont tombées. Je m'intéressais à la fin de l'automne ou au début du printemps, juste après la chute des neiges, au type de complexité et de texture que l'on obtient, au type de chaos que l'on trouve dans la forêt et les broussailles. J'ai réalisé toute une série en essayant de comprimer cet espace, peut-être en m'inspirant un peu de l'expressionnisme abstrait et de l'aplatissement de l'espace.
La notion même de chaos, c'est-à-dire lorsque vous marchez dans une forêt, est chaotique. C'est chaotique. C'est très détaillé, surtout quand les feuilles sont toutes tombées. Il n'y a pas de vert. On ne voit que des branches, des feuilles, des broussailles, tout ça. Pour moi, il s'agissait d'atténuer mon œil, de pouvoir marcher dans un espace chaotique et, d'une certaine manière, de l'entraîner de telle sorte que, tout à coup, il semble que l'image ait toujours eu un sens. C'est une image intéressante parce que toute cette agitation devient tendue. Elle crée une image qui est fascinante à regarder.
C'est comme si j'avais appris mes gammes dans la forêt. Maintenant, j'entre dans une entreprise minière et je commence à errer, à regarder et à m'étonner de ce chaos, et d'un endroit qui est, dans l'ensemble, plutôt laid et ennuyeux. La plupart des gens entreraient dans une mine et en ressortiraient en disant : "Bon sang, c'est plutôt sinistre, visuellement". Moi, j'y entre et je me dis que je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à essayer de comprendre comment la photographier de manière à ce que les gens ne détournent pas les yeux lorsqu'ils la regardent. J'ai utilisé une partie de la technique que j'avais développée en photographiant ce paysage et en appliquant la même atténuation à un lieu.
La plupart des gens entreraient dans une mine et en ressortiraient en se disant : "Bon sang, c'est plutôt sinistre, visuellement". Moi, j'y entre et je me dis que je ne vais pas abandonner.
Par exemple, j'ai décidé à un moment donné d'aller photographier des raffineries, parce que c'est de là que viennent les plastiques ; le pétrole, le gaz, le kérosène, le butane et le kérosène, tout cela vient de cet endroit. J'y suis allé et j'ai fait ma première prise de vue avec un appareil photo de deux pouces et quart, en me promenant et en voyant ce qu'il était possible de faire là-dedans. J'ai pris quelques rouleaux de film 1-20, une sorte d'esquisse. À mon retour, j'ai trouvé sur la pellicule quatre ou cinq images que je trouvais intéressantes. Je les ai imprimées et agrandies. Je suis ensuite retourné sur place et j'ai photographié avec toute une série de matériaux différents. J'ai utilisé des films Ektachrome, Fujifilm et Polaroid, je suis revenu et j'ai développé le film pour voir comment il allait réagir. J'ai commencé à imprimer sur différents papiers. J'ai ensuite combiné ces deux éléments et j'ai maintenant réduit mes matériaux à ce que je veux et à la palette que je trouve efficace dans cet espace.
Tout en continuant à photographier, je travaille également sur ce que je photographie. Je prends plus d'images, peut-être deux images sont-elles intéressantes et les autres le sont moins. Je commence à réfléchir à la raison pour laquelle elles sont intéressantes. Je pense que lors de mon quatrième ou cinquième voyage, j'ai finalement atteint le point où je me suis dit que j'avais trouvé un moyen de capturer ces images de manière convaincante. J'ai travaillé dans le chaos et la complexité et j'ai trouvé où je pense que les images résident - où elles sont devenues intéressantes.
Dans la plupart des cas, c'est le processus que je suivrais. Je continue jusqu'à ce que j'aie réussi à distiller le moment visuel qui, selon moi, inciterait quelqu'un à regarder une raffinerie. À bien des égards, ces raffineries ressemblaient à des cathédrales, à des palais industriels - des tuyaux, de la vapeur, de grosses chaudières à pression, tout cet aluminium brillant. Les gars qui y travaillaient se promenaient à vélo et s'arrêtaient pour dire : "Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi voulez-vous photographier ça ?"
Cela nous ramène à l'une des choses que j'ai aimées chez certains des premiers modernistes, comme Edward Weston, qui prenait [quelque chose] de quotidien ou de banal, comme un poivron ou un chou, et le coupait en deux. Tout d'un coup, cela ressemble à un nu éblouissant et sensuel, presque. Voir l'extraordinaire dans l'ordinaire par l'acte de perception, à bien des égards, je partage cette intrigue ; les choses devant lesquelles les gens passent sans jamais y penser, j'irais les voir et j'essaierais alors de trouver l'extraordinaire là-dedans.

Edward Burtynsky, Carrières de marbre de Carrare, Cava di Canalgrande #1, Carrare, Italie, 2016. Impression à jet d'encre pigmentaire sur papier photo professionnel Kodak © Edward Burtynsky, avec l'aimable autorisation de la Metivier Gallery, Toronto.
J'ai une dernière question. Dans ces nouvelles œuvres, vous avez revisité les carrières de marbre de Carrare et pris de nouvelles images. Je m'intéresse à la manière dont vous suivez les progrès réalisés dans les carrières. Qu'est-ce qui vous a incité à les revisiter ? Souhaitez-vous réfléchir à la temporalité de la photographie et à sa relation avec le temps dans ces images ?
C'était intéressant parce qu'il s'agissait de quelques-unes des plus grandes carrières du monde, et je revenais 25 ans plus tard après les avoir photographiées pour la première fois. Nous avons cherché des industries extractives à grande échelle dans nos discussions, parce que nous travaillons en collaboration.
Je pensais que Carrara représentait une étape importante dans ma carrière, car jusqu'en 1992, je n'avais tourné qu'en Amérique du Nord. En 1992, j'avais entendu parler des incroyables carrières de Carrare, dans le nord de l'Italie. Je ne parlais pas la langue et je ne savais pas comment m'y prendre. Mais je suis tombé sur un photographe italien à Toronto Image Works, à Toronto. Il m'a dit qu'il connaissait un gars dans la région qui était assistant photographe. J'ai appelé Sylvio, il parlait bien anglais, j'ai donc passé un accord avec lui et il m'a servi de guide. Il est sorti à l'avance et a négocié pour que je puisse prendre des photos.
Tout à coup, je tournais dans un pays dont je ne parlais pas la langue, je ne tournais plus en Amérique du Nord et j'ai déménagé tout mon matériel là-bas. C'était le début d'une réflexion sur la planète dans son ensemble, et pas seulement sur l'Amérique du Nord. Je me suis dit qu'il serait intéressant de retourner à Carrare exactement 25 ans plus tard.
Mais maintenant, j'y retourne avec des drones, même pas avec un film, c'est tout numérique, avec la possibilité d'assembler des images et toute cette technologie que je maîtrise. J'y suis allé avec toute une série d'outils dont je n'aurais jamais pu rêver, [notamment] un Hasselblad de 100 mégapixels monté sur un drone [pour pouvoir] filmer dans toutes les perspectives que je voulais. J'ai donc pu photographier les carrières d'une manière dont je ne pouvais que rêver. Le Hasselblad 100 pixels est certainement meilleur qu'un 4×5, peut-être pas qu'un 8×10, mais quelque part entre les deux. J'ai la possibilité de placer mon appareil presque n'importe où et de photographier. Pour moi, c'était un moment très excitant de retourner sur un site, avec 25 ans d'expérience et d'outils.
Wow. C'était une façon de revisiter ce moment formateur pour vous. C'est merveilleux. Cela a dû être très agréable de réfléchir à la manière dont vous avez commencé à photographier dans le monde entier et de revenir avec toute votre expérience. L'ensemble de l'exposition semble également cumuler votre travail.
Le mot [Anthropocène] et l'idée semblent être un parapluie étonnant, une canopée sous laquelle une grande partie du travail que j'ai effectué semble s'inscrire. Je me suis concentré sur les interventions humaines à grande échelle dans le paysage. Pour en revenir à la marche dans la nature et à la notion de temps géologique, je l'ai acquise à mes débuts en tant que passionné de canoë-kayak et de camping. En pagayant le long des rives de ces grands lacs du nord de l'Ontario, c'est exactement ce qu'un membre des Premières nations aurait vu il y a 10 000 ou 15 000 ans, à chaque fois qu'il est arrivé là. Et peut-être qu'un castor qui passait par là l'aurait vu il y a 100 000 ans.
Ce point de référence profond à ce que la nature a voulu dans ce paysage, qui pour moi parle de temps géologiques profonds - c'est ainsi que cela s'est passé pendant de nombreux millénaires. La motivation, c'est d'aller voir comment nous remodelons la nature, d'avoir de l'empathie pour la perte de cette nature. C'est une sorte de lamentation pour la perte de la nature avec cette empreinte humaine qui s'étend maintenant à travers le monde. Je considère l'ensemble de l'œuvre comme une complainte silencieuse : un regard sur notre succès et sur le coût de toutes les autres formes de vie sur la planète.

Edward Burtynsky, Bassin de résidus de phosphore #4, près de Lakeland, Floride, États-Unis, 2012. Impression à jet d'encre pigmentaire sur papier photo professionnel Kodak © Edward Burtynsky, avec l'aimable autorisation de la Metivier Gallery, Toronto.

Edward Burtynsky, Estacades de grumes #1, île de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, 2016. Impression à jet d'encre pigmentaire sur papier photo professionnel Kodak © Edward Burtynsky, avec l'aimable autorisation de la Metivier Gallery, Toronto.
Image de couverture : Edward Burtynsky, Mine de potasse d'Uralkali #4, Berezniki, Russie, 2017 (détail). Impression jet d'encre pigmentaire sur papier photo professionnel Kodak © Edward Burtynsky, avec l'aimable autorisation de la Metivier Gallery, Toronto.